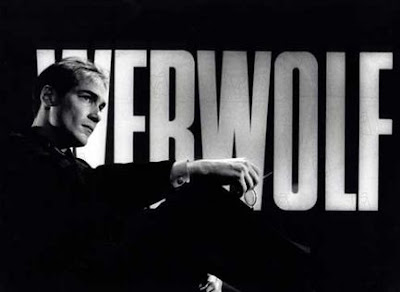Par Nicolas Debarle
Tourner à Londres, loin d’Helsinki
J’ai engagé un tueur intervient dans la filmographie d’Aki Kaurismäki à une période charnière de remise en question. Peu après avoir quitté la Finlande pour suivre les Leningrad Cowboys lors de leur (fausse) tournée aux Etats-Unis et au Mexique, le cinéaste décide de tourner deux longs-métrages, en Angleterre, puis en France, et de laisser de côté, pour un temps, la ville d’Helsinki qu’il prétend connaitre au millimètre près. Tourné dans la banlieue de Londres en 1990, J’ai engagé un tueur, le premier film de ce diptyque européen, répond par voie de faits à deux désirs distincts : d’un côté, l’envie de s’implanter dans de nouveaux décors, de travailler au sein de nouveaux cadres de production et de profiter, d’un autre côté, de l’opportunité d’un tel dépaysement pour se revendiquer de nouvelles formes cinématographiques.
Tant sur le plan géographique que d’un point de vue esthétique, il s’agit bien pour le cinéaste de se redonner du souffle et d’empêcher coûte que coûte la sclérose de son cinéma. Malgré la finesse de leur portée émotionnelle, les formes tragiques et amères de La Fille aux Allumettes (1990) – le dernier film authentiquement finlandais de Kaurismäki, à cette période – ont ceci d’alarmant pour un cinéaste en quête de légitimité qu’elles débouchent sur une conception de la mise en scène d’une telle radicalité qu’il parait vain de la poursuivre consciencieusement. Film du réapprentissage et de l’adaptation (au sens où l’on s’adapte à un pays et à des coutumes étrangères), J’ai engagé un tueur se définit, par l’identité même de son projet, comme un film ouvert à de nouveaux horizons, à d’inédites correspondances.
Un réseau de références
Le long-métrage anglais de Kaurismäki (le seul, en effet, dans sa filmographie) se situe au croisement de deux postures complémentaires. Le point de départ du récit, sa situation générale, amorce une trajectoire thématique souvent empruntée dans les films du cinéaste finlandais : l’exclusion, le chômage et la détresse, tant matérielle que psychologique, qui s’ensuit. Accablé et replié sur lui-même, Henri Boulanger, le personnage principal du film, un français exilé à Londres, est séparé, dès les premiers plans, de la société dans laquelle il vit. Suscitant l’indifférence de ses collègues de travail, le protagoniste s’isole au point de passer à leur égard pour un véritable fantôme. Suite à son licenciement, le protagoniste finit par ne plus penser qu’à une chose : le suicide. Passé maître dans l’art de scruter la vie des marginaux et autres laissés-pour-compte des sociétés modernes, Kaurismäki commence d’abord par trouver à Londres ce qu’il avait précisément laissé à Helsinki… De même, les premiers plans sur la capitale anglaise affichent une étonnante ressemblance avec les vues urbaines des précédents films. Le parti pris est le même : de Londres, nous ne verrons que les faubourgs – cadre de vie de toute sorte de petites gens.
Filmer Londres, en effet, pour Kaurismäki, ne consiste pas à placer la caméra devant Piccadilly Circus et à faire en sorte que quelques bus rouges passent à travers le champ. Bien plus subtile et soignée que cela, la représentation de Londres n’engage aucune sorte de cliché touristique, mais repose sur un réseau de références proprement cinématographiques. La ville, tout au long du film, ne renvoie jamais à elle-même, mais aux images que le cinéma a su, peu à peu, fabriquer d’elle. Ainsi, à l’instar du personnage principal, Londres pourrait bien, à son tour, n’être que le fantôme de lui-même.
Cinéphile des plus avertis, Kaurismäki n’a jamais caché, depuis le début de sa carrière, ses nombreuses sources d’inspiration (Renoir, De Sica, Ozu, Hawks, Sirk, Capra, Bresson, Godard… etc.). Celles-ci, d’une certaine façon, ont tendance à former un capital plus ou moins valorisé dont chaque film mis en chantier libère une partie des ressources. De par la tournure dramatique de son intrigue, son attachement à une forme de burlesque dérisoire et son ambiance brumeuse caractéristique, J’ai engagé un tueur souligne une forte filiation avec des genres aussi divers que le film noir (Powell, Hitchcock), la comédie sociale du type des Studios Ealing (Tueurs de dames de Mackendrick) et le film de vampire de l’époque du muet (Nosferatu de Murnau). Si le fait de tourner à Londres permet au cinéaste d’aborder certains genres cinématographiques en toute impunité, ces derniers, en retour, lui fournissent les outils nécessaires au déploiement de sa propre stylistique.
Vampirisme cinématographique
On sait l’importance que peut tenir le cinéma dit classique, ou plus généralement, celui des temps anciens dans les films de Kaurismäki. Ce n’est pas un hasard, en effet, si celui-ci a réalisé Juha en 1999, « le dernier film muet du XXème siècle ». Le cinéaste, incontestablement, montre une préférence pour les formes simples et sommaires telles qu’elles ont été pratiquées, selon les réalisateurs, à différentes périodes de l’Histoire du cinéma. Peut-on pour autant avancer l’idée que les films de Kaurismäki relèvent d’un cinéma rétrograde, conçu dans le seul but de raviver les ombres du passé ?
La présence de Jean-Pierre Léaud dans le rôle principal du film détonne quant à la cohérence des repères cinématographiques établis. Outre le caractère anecdotique d’un tel choix de casting (Léaud renvoie, bien évidement, à la Nouvelle Vague française dans la mesure où le film pourrait très bien se dérouler quelque part à la suite des aventures d’Antoine Doinel, celui-ci ayant raté la carrière à laquelle il s’était destiné), l’interprétation très particulière du personnage d’Henri par Léaud (une interprétation à la Matti Pellonpää – acteur fétiche de Kaurismäki – faisant passer le tragique des situations sous le couvert d’un certain burlesque) vise à court-circuiter l’ensemble des codes dramaturgiques sous-jacents à l’élaboration du film. Léaud, constamment, façonne son personnage de l’extérieur et semble toujours en train de se regarder jouer. Ses réactions, aussi peu naturelles qu’elles puissent paraitre, marquent d’un bout à l’autre du film une remarquable volonté de distanciation.
Relégué en dehors de l’atypique cheminement du drame, le spectateur en vient plus à découvrir les choses et à se laisser surprendre par elles qu’à les reconnaitre et les identifier. Le réel, toujours chez Kaurismäki, n’est jamais donné pour lui-même. Les événements, en général, ne se déroulent pas comme ils devraient logiquement le faire (un exemple : pourquoi se soucier d’un bouquet de fleurs comme le font les deux protagonistes principaux alors qu’un tueur à ce moment est à leurs trousses ?). L’essentiel de l’approche stylistique du cinéaste concoure, dans cette optique, à souligner les différences qualitatives entre les événements proprement dits et leur représentation dans le tissu filmique. « Réaliste », Kaurismäki l’est sûrement si l’on se réfère à la situation psychologique et sociale brossée par le film, mais en aucun cas si l’on considère les tenants singuliers de la mise en scène.
Question de découpage, tout d’abord : le film comprend un nombre important d’ellipses temporelles à travers lesquelles se profile le rejet des formes traditionnelles de la continuité narrative. Le long-métrage, de fait, se voit construit sur la base d’une succession de saynètes. Ce qui se passe à l’écran ne concerne pas tant l’évolution psychologique des personnages, mais plus précisément l’amorce ou le point d’aboutissement de cette même évolution. Souvent fixe et particulièrement tranché, le cadre tend, de son côté, à resserrer les éléments dans le champ de la caméra et à isoler les personnages sur eux-mêmes.
Jouant la carte du minimalisme laconique, Kaurismäki se livre à une stricte économie de moyens et élimine de son film toute expression superflue. Les dialogues, les mouvements de caméra et tout procédé de signification sont restreints à leur plus simple ajustement. Il suffit, en ce sens, d’une parole, d’un geste ou d’un regard pour épuiser toute l’étendue du possible. Cherchant bien plus à composer avec le réel qu’à le reproduire pour ce qu’il est, Kaurismäki s’oppose, non sans ingéniosité, à la transparence cinématographique telle qu’Hollywood a pu la définir au fil de son Histoire. Film foncièrement vampirique, J’ai engagé un tueur revisite un certain nombre de genres on ne peut plus classiques, à l’aune d’une conception sensiblement plus moderne du cinéma, du type Nouvelle Vague.
Surfaces, couleurs et musiques
J’ai engagé un tueur répond, en tout et pour tout, à une double opération de sélection et de condensation des moyens expressifs propres au septième art. Synthétisant le réel pour le tirer tantôt vers le pathétique, tantôt vers le burlesque, et souvent vers les deux à la fois, Kaurismäki renverse le processus expressif traditionnellement adopté par la plupart des films de fiction. Il ne s’agit plus de retenir du monde l’expression d’une idée, mais, tout au contraire, de retenir d’une idée l’effervescence d’un monde.
De même que l’idée de solitude est directement exprimée par l’utilisation des cadrages, le thème central du film – la rencontre amoureuse – se voit introduit, quant à lui, par l’utilisation des couleurs, le langage même des images. On peut facilement remarquer qu’un fort contraste se créé entre deux gammes de couleurs largement employées au cours du film. Associées au cadre de vie du personnage d’Henri – cadre de vie qui, à l’image de ce dernier, se définit par son aspect morne et triste, les couleurs froides que sont le bleu et le vert s’insinuent partout là où le personnage semble en plein désarroi existentiel. L’appartement d’Henri – lieu où s’accomplit le plus nettement la solitude du protagoniste – apparait à l’écran sous des teintes bleuâtres particulièrement ombragées et menaçantes. , la rencontre avec l’être aimé, Margaret, la vendeuse de fleurs, se traduit par une vive irruption de la couleur rouge – couleur qui, associée au jaune, se porte pour la première fois sur un personnage et ne cesse, d’une manière ou d’une autre, de renvoyer à la question du désir
Ainsi, avant même que le couple finisse par s’entendre et que les genres sexuels finissent par se rejoindre, le film suggère la réciprocité des deux protagonistes par la réunion des couleurs froides et des couleurs chaudes. Vient alors se greffer, sur un second plan, le noir qui, opposé aux contrastes des couleurs, symbolise le souffle de la mort planant au-dessus du personnage principal. L’idée est évidente dans la mesure où le noir, dans la dernière séquence, envahit presque toute l’image. Tous ces rapports chromatiques, de plus, se voient soulignés par la quasi-absence de profondeur de champ. L’image, en effet, est appréhendée comme une simple surface sur laquelle s’entremêlent plusieurs plans colorés, en adéquation avec le ressenti du personnage central.
L’utilisation de la musique, en parallèle avec le travail de la couleur, ne renseigne jamais sur la tournure dramatique des épisodes du film, mais, imprégnant les séquences d’une ambiance précise et déterminée, conduit le déroulement du long-métrage en ses propres termes. Si les premières scènes s’accordent avec du blues, les passages suivants évoluent au rythme d’une partition nettement plus orienté vers le rock’n’roll. La scène dévolue à la performance musicale de Joe Strummer est significative dans la mesure où elle déclenche un rebondissement de l’intrigue. A l’accablement du début s’oppose là, chez le personnage, une recrudescence d’adrénaline.
La liberté du regard
Sur le modèle de tous les personnages des films de Kaurismäki, Henri Boulanger se trouve confronté à certains choix. La nature des rencontres qu’il effectue et des évènements qui le concernent conduit le protagoniste à se forger peu à peu une nouvelle identité. Le monde, au fil de l’intrigue, prend un sens que le personnage ne soupçonnait guère au début.
Résolu à ne pas représenter le réel en soi (ou presque, à l’en croire les premiers plans quasi documentaires du film), mais à donner corps à une série de forces expressives au travail, Kaurismäki choisit de traiter sur un plan objectif les termes constitutifs d’une certaine subjectivité. Portée par le regard du personnage d’Henri – et par là, du cinéaste lui-même, la représentation de Londres se dote d’une opacité sémantique particulièrement fine et toujours plus prononcée.
Suscitant l’attention du spectateur au sens du moindre détail, le cinéaste nous apprend, par le biais d’une telle conception de l’image, à regarder les choses autrement et en toute liberté, sans désormais avoir à les subir.
Tourner à Londres, loin d’Helsinki
J’ai engagé un tueur intervient dans la filmographie d’Aki Kaurismäki à une période charnière de remise en question. Peu après avoir quitté la Finlande pour suivre les Leningrad Cowboys lors de leur (fausse) tournée aux Etats-Unis et au Mexique, le cinéaste décide de tourner deux longs-métrages, en Angleterre, puis en France, et de laisser de côté, pour un temps, la ville d’Helsinki qu’il prétend connaitre au millimètre près. Tourné dans la banlieue de Londres en 1990, J’ai engagé un tueur, le premier film de ce diptyque européen, répond par voie de faits à deux désirs distincts : d’un côté, l’envie de s’implanter dans de nouveaux décors, de travailler au sein de nouveaux cadres de production et de profiter, d’un autre côté, de l’opportunité d’un tel dépaysement pour se revendiquer de nouvelles formes cinématographiques.
Tant sur le plan géographique que d’un point de vue esthétique, il s’agit bien pour le cinéaste de se redonner du souffle et d’empêcher coûte que coûte la sclérose de son cinéma. Malgré la finesse de leur portée émotionnelle, les formes tragiques et amères de La Fille aux Allumettes (1990) – le dernier film authentiquement finlandais de Kaurismäki, à cette période – ont ceci d’alarmant pour un cinéaste en quête de légitimité qu’elles débouchent sur une conception de la mise en scène d’une telle radicalité qu’il parait vain de la poursuivre consciencieusement. Film du réapprentissage et de l’adaptation (au sens où l’on s’adapte à un pays et à des coutumes étrangères), J’ai engagé un tueur se définit, par l’identité même de son projet, comme un film ouvert à de nouveaux horizons, à d’inédites correspondances.
Un réseau de références
Le long-métrage anglais de Kaurismäki (le seul, en effet, dans sa filmographie) se situe au croisement de deux postures complémentaires. Le point de départ du récit, sa situation générale, amorce une trajectoire thématique souvent empruntée dans les films du cinéaste finlandais : l’exclusion, le chômage et la détresse, tant matérielle que psychologique, qui s’ensuit. Accablé et replié sur lui-même, Henri Boulanger, le personnage principal du film, un français exilé à Londres, est séparé, dès les premiers plans, de la société dans laquelle il vit. Suscitant l’indifférence de ses collègues de travail, le protagoniste s’isole au point de passer à leur égard pour un véritable fantôme. Suite à son licenciement, le protagoniste finit par ne plus penser qu’à une chose : le suicide. Passé maître dans l’art de scruter la vie des marginaux et autres laissés-pour-compte des sociétés modernes, Kaurismäki commence d’abord par trouver à Londres ce qu’il avait précisément laissé à Helsinki… De même, les premiers plans sur la capitale anglaise affichent une étonnante ressemblance avec les vues urbaines des précédents films. Le parti pris est le même : de Londres, nous ne verrons que les faubourgs – cadre de vie de toute sorte de petites gens.
Filmer Londres, en effet, pour Kaurismäki, ne consiste pas à placer la caméra devant Piccadilly Circus et à faire en sorte que quelques bus rouges passent à travers le champ. Bien plus subtile et soignée que cela, la représentation de Londres n’engage aucune sorte de cliché touristique, mais repose sur un réseau de références proprement cinématographiques. La ville, tout au long du film, ne renvoie jamais à elle-même, mais aux images que le cinéma a su, peu à peu, fabriquer d’elle. Ainsi, à l’instar du personnage principal, Londres pourrait bien, à son tour, n’être que le fantôme de lui-même.
Cinéphile des plus avertis, Kaurismäki n’a jamais caché, depuis le début de sa carrière, ses nombreuses sources d’inspiration (Renoir, De Sica, Ozu, Hawks, Sirk, Capra, Bresson, Godard… etc.). Celles-ci, d’une certaine façon, ont tendance à former un capital plus ou moins valorisé dont chaque film mis en chantier libère une partie des ressources. De par la tournure dramatique de son intrigue, son attachement à une forme de burlesque dérisoire et son ambiance brumeuse caractéristique, J’ai engagé un tueur souligne une forte filiation avec des genres aussi divers que le film noir (Powell, Hitchcock), la comédie sociale du type des Studios Ealing (Tueurs de dames de Mackendrick) et le film de vampire de l’époque du muet (Nosferatu de Murnau). Si le fait de tourner à Londres permet au cinéaste d’aborder certains genres cinématographiques en toute impunité, ces derniers, en retour, lui fournissent les outils nécessaires au déploiement de sa propre stylistique.
Vampirisme cinématographique
On sait l’importance que peut tenir le cinéma dit classique, ou plus généralement, celui des temps anciens dans les films de Kaurismäki. Ce n’est pas un hasard, en effet, si celui-ci a réalisé Juha en 1999, « le dernier film muet du XXème siècle ». Le cinéaste, incontestablement, montre une préférence pour les formes simples et sommaires telles qu’elles ont été pratiquées, selon les réalisateurs, à différentes périodes de l’Histoire du cinéma. Peut-on pour autant avancer l’idée que les films de Kaurismäki relèvent d’un cinéma rétrograde, conçu dans le seul but de raviver les ombres du passé ?
La présence de Jean-Pierre Léaud dans le rôle principal du film détonne quant à la cohérence des repères cinématographiques établis. Outre le caractère anecdotique d’un tel choix de casting (Léaud renvoie, bien évidement, à la Nouvelle Vague française dans la mesure où le film pourrait très bien se dérouler quelque part à la suite des aventures d’Antoine Doinel, celui-ci ayant raté la carrière à laquelle il s’était destiné), l’interprétation très particulière du personnage d’Henri par Léaud (une interprétation à la Matti Pellonpää – acteur fétiche de Kaurismäki – faisant passer le tragique des situations sous le couvert d’un certain burlesque) vise à court-circuiter l’ensemble des codes dramaturgiques sous-jacents à l’élaboration du film. Léaud, constamment, façonne son personnage de l’extérieur et semble toujours en train de se regarder jouer. Ses réactions, aussi peu naturelles qu’elles puissent paraitre, marquent d’un bout à l’autre du film une remarquable volonté de distanciation.
Relégué en dehors de l’atypique cheminement du drame, le spectateur en vient plus à découvrir les choses et à se laisser surprendre par elles qu’à les reconnaitre et les identifier. Le réel, toujours chez Kaurismäki, n’est jamais donné pour lui-même. Les événements, en général, ne se déroulent pas comme ils devraient logiquement le faire (un exemple : pourquoi se soucier d’un bouquet de fleurs comme le font les deux protagonistes principaux alors qu’un tueur à ce moment est à leurs trousses ?). L’essentiel de l’approche stylistique du cinéaste concoure, dans cette optique, à souligner les différences qualitatives entre les événements proprement dits et leur représentation dans le tissu filmique. « Réaliste », Kaurismäki l’est sûrement si l’on se réfère à la situation psychologique et sociale brossée par le film, mais en aucun cas si l’on considère les tenants singuliers de la mise en scène.
Question de découpage, tout d’abord : le film comprend un nombre important d’ellipses temporelles à travers lesquelles se profile le rejet des formes traditionnelles de la continuité narrative. Le long-métrage, de fait, se voit construit sur la base d’une succession de saynètes. Ce qui se passe à l’écran ne concerne pas tant l’évolution psychologique des personnages, mais plus précisément l’amorce ou le point d’aboutissement de cette même évolution. Souvent fixe et particulièrement tranché, le cadre tend, de son côté, à resserrer les éléments dans le champ de la caméra et à isoler les personnages sur eux-mêmes.
Jouant la carte du minimalisme laconique, Kaurismäki se livre à une stricte économie de moyens et élimine de son film toute expression superflue. Les dialogues, les mouvements de caméra et tout procédé de signification sont restreints à leur plus simple ajustement. Il suffit, en ce sens, d’une parole, d’un geste ou d’un regard pour épuiser toute l’étendue du possible. Cherchant bien plus à composer avec le réel qu’à le reproduire pour ce qu’il est, Kaurismäki s’oppose, non sans ingéniosité, à la transparence cinématographique telle qu’Hollywood a pu la définir au fil de son Histoire. Film foncièrement vampirique, J’ai engagé un tueur revisite un certain nombre de genres on ne peut plus classiques, à l’aune d’une conception sensiblement plus moderne du cinéma, du type Nouvelle Vague.
Surfaces, couleurs et musiques
J’ai engagé un tueur répond, en tout et pour tout, à une double opération de sélection et de condensation des moyens expressifs propres au septième art. Synthétisant le réel pour le tirer tantôt vers le pathétique, tantôt vers le burlesque, et souvent vers les deux à la fois, Kaurismäki renverse le processus expressif traditionnellement adopté par la plupart des films de fiction. Il ne s’agit plus de retenir du monde l’expression d’une idée, mais, tout au contraire, de retenir d’une idée l’effervescence d’un monde.
De même que l’idée de solitude est directement exprimée par l’utilisation des cadrages, le thème central du film – la rencontre amoureuse – se voit introduit, quant à lui, par l’utilisation des couleurs, le langage même des images. On peut facilement remarquer qu’un fort contraste se créé entre deux gammes de couleurs largement employées au cours du film. Associées au cadre de vie du personnage d’Henri – cadre de vie qui, à l’image de ce dernier, se définit par son aspect morne et triste, les couleurs froides que sont le bleu et le vert s’insinuent partout là où le personnage semble en plein désarroi existentiel. L’appartement d’Henri – lieu où s’accomplit le plus nettement la solitude du protagoniste – apparait à l’écran sous des teintes bleuâtres particulièrement ombragées et menaçantes. , la rencontre avec l’être aimé, Margaret, la vendeuse de fleurs, se traduit par une vive irruption de la couleur rouge – couleur qui, associée au jaune, se porte pour la première fois sur un personnage et ne cesse, d’une manière ou d’une autre, de renvoyer à la question du désir
Ainsi, avant même que le couple finisse par s’entendre et que les genres sexuels finissent par se rejoindre, le film suggère la réciprocité des deux protagonistes par la réunion des couleurs froides et des couleurs chaudes. Vient alors se greffer, sur un second plan, le noir qui, opposé aux contrastes des couleurs, symbolise le souffle de la mort planant au-dessus du personnage principal. L’idée est évidente dans la mesure où le noir, dans la dernière séquence, envahit presque toute l’image. Tous ces rapports chromatiques, de plus, se voient soulignés par la quasi-absence de profondeur de champ. L’image, en effet, est appréhendée comme une simple surface sur laquelle s’entremêlent plusieurs plans colorés, en adéquation avec le ressenti du personnage central.
L’utilisation de la musique, en parallèle avec le travail de la couleur, ne renseigne jamais sur la tournure dramatique des épisodes du film, mais, imprégnant les séquences d’une ambiance précise et déterminée, conduit le déroulement du long-métrage en ses propres termes. Si les premières scènes s’accordent avec du blues, les passages suivants évoluent au rythme d’une partition nettement plus orienté vers le rock’n’roll. La scène dévolue à la performance musicale de Joe Strummer est significative dans la mesure où elle déclenche un rebondissement de l’intrigue. A l’accablement du début s’oppose là, chez le personnage, une recrudescence d’adrénaline.
La liberté du regard
Sur le modèle de tous les personnages des films de Kaurismäki, Henri Boulanger se trouve confronté à certains choix. La nature des rencontres qu’il effectue et des évènements qui le concernent conduit le protagoniste à se forger peu à peu une nouvelle identité. Le monde, au fil de l’intrigue, prend un sens que le personnage ne soupçonnait guère au début.
Résolu à ne pas représenter le réel en soi (ou presque, à l’en croire les premiers plans quasi documentaires du film), mais à donner corps à une série de forces expressives au travail, Kaurismäki choisit de traiter sur un plan objectif les termes constitutifs d’une certaine subjectivité. Portée par le regard du personnage d’Henri – et par là, du cinéaste lui-même, la représentation de Londres se dote d’une opacité sémantique particulièrement fine et toujours plus prononcée.
Suscitant l’attention du spectateur au sens du moindre détail, le cinéaste nous apprend, par le biais d’une telle conception de l’image, à regarder les choses autrement et en toute liberté, sans désormais avoir à les subir.